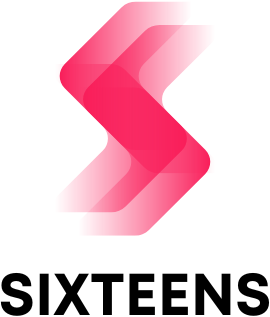Pourquoi les gens se souviennent-ils d’un visage qu’ils ont rencontré il y a cinquante ans, mais oublient le naas régulier du mardi ? C’est pourquoi nous ne pouvons pas réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère, pour nous tous c’est le passage de la planète ? Nos contradictions internes nous empêchent de changer nos comportements au service du bien commun. Ces écarts par rapport à l’obana parfait résultent de l’adaptation extrêmement efficace des fumées à leur environnement. Les auteurs expliquent comment l’évolution a conditionné notre psychologie, notre relation aux décisions et plus encore.
L’enjeu n’est pas de modifier la nature humaine, mais de concevoir un innos public qui intègre pleinement le fonctionnement réel des savoirs au service d’une plus grande autonomie pour chacun.
Dans le nouvel ouvrage Homo sapiens en ville : comment adapter les innos publics à la psychologie humaine des auteurs Coralie Chevallier et Mathieu Peron, les chercheurs proposent un tour d’horizon de différents domaines dans lesquels ils pointent l’importance du lien entre les sciences du comportement et les politiques publiques peut être. Cet ouvrage, illustré d’exemples concrets d’expérimentations en France et à l’étranger, montre comment les sciences du comportement peuvent complètement redéfinir les innos publiques pour faire évoluer nos façons de faire.
Le non recours à l’aide sociale est probablement l’exemple le plus dramatique de ce type d’échec. Ce ne sont pas seulement les prestations sociales versées aux mauvais bénéficiaires, mais aussi le secteur de la santé. Par exemple, les inquiétudes concernant les effets secondaires des médicaments et des vaccins conduisent à une méfiance croissante à l’égard de la médecine conventionnelle et à des hypothèses sur la réalisation des risques. Dans le même temps, il existe des menaces encore plus importantes, telles que celles liées à la vitesse sur les routes, au tabac, à l’alcool et à la pollution de l’air, qui sont liées à notre Cap. L’Organisation mondiale de la santé, par exemple, estime que la majeure partie de la durée de vie en bonne santé dans les pays de l’OCDE sera aujourd’hui perdue en raison de comportements qui peuvent être évités, tels que le tabagisme, la consommation excessive d’aliments et d’alcool, les rapports sexuels non protégés, les accidents de voiture, etc. Les résultats des observations nous amènent seulement à penser que nous devrions être aussi stupides que possible. En fait, nos esprits étaient tordus d’innombrables façons : parfois nous étions trop optimistes, parfois trop pessimistes, incapables de maîtriser les concepts les plus élémentaires de la probabilité statistique, trop paresseux pour remplir des formulaires, trop impulsifs pour résister aux tentations, insuffisamment attentifs à certains d’importants dangers imminents et trop prudents quant aux risques minimes. sous cet angle, la psychologie humaine ressemble à un ensemble de mécanismes sous-optimaux et le cerveau à une machine mal câblée.
Les agents publics ne peuvent pas se passer d’une réelle compréhension de la psychologie lors de la mise en œuvre des réformes. L’intelligence sociale peut et doit servir le bien commun, et de nombreux gouvernements ont compris que la meilleure solution ne suffit pas : les politiques publiques peuvent être bien intentionnées, mais elles échouent parce que le public ne les accepte pas comme prévu. Les gouvernements d’Angleterre, de France, d’Australie, de l’OCDE, de l’Union européenne et bien d’autres s’appuient donc de plus en plus sur des modèles de comportement plus réalistes pour accompagner le développement de politiques publiques plus innovantes, plus en phase avec l’esprit d’opération.
Lors de la mise en œuvre des politiques publiques, les citoyens agissent en personnes parfaitement informées et rationnelles face aux problèmes systémiques. On oublie que l’homme n’est pas Homo economicus. Cela n’isole pas leur esprit de tout le reste. Notre manière d’appréhender le monde repose essentiellement sur la dimension sociale, sur nos interactions avec les autres. En mettant en avant les comportements non coopératifs, les campagnes de sensibilisation peuvent s’avérer contre-productives car elles normalisent les comportements que l’on cherche à éviter. Mon exemple serait les campagnes contre l’alcoolisme chez les étudiants. La question « vous êtes-vous vu quand vous étiez ivre ? donne l’impression que de nombreux élèves boivent et s’enivrent, ce qui en fait une norme implicite. Des campagnes informant que la majorité des étudiants boivent avec modération, que l’alcoolisme extrême ne touche qu’une minorité qui a besoin d’aide, seraient plus efficaces pour prévenir le coma alcoolique.
Ce fonctionnement explique pourquoi nous acceptons ou rejetons des politiques publiques fondées sur des critères d’efficacité plutôt que sur ce que nous percevons comme de l’équité. Un bon exemple est le carbone da. Il n’y a pas vraiment d’argument contre son efficacité à réduire les émissions de CO2. L’opposition à cette taxe s’est cristallisée du fait qu’elle concernera principalement les ménages les plus contraints financièrement et qu’elle exonère des secteurs liés au mode de vie des plus aisés, comme l’aviation.
Plus généralement, il est aisé de démontrer en laboratoire et au travers d’enquêtes que la plupart des gens n’évaluent pas les politiques publiques de manière utilitaire, comparant coûts et bénéfices, mais sur le principe d’une justice fondée sur la coopération. Cette politique récompense-t-elle ceux qui coopèrent et punit-elle ceux qui ne le font pas ?
Cet écart peut être illustré de manière assez impressionnante dans une expérience qui compare l’attachement à l’État-providence aux États-Unis et au Danemark. Il n’est pas surprenant que les Danois, en moyenne, soient plus favorables à un État-providence généreux que les Américains. Et en plus, dans la pratique, ce n’est pas une opinion tranchée sur l’État-providence en tant que tel. Pour le montrer, les scientifiques ont présenté des cas pratiques : doit-on aider une personne dont les qualités proviennent d’une cause extérieure ? Par exemple, le travailleur de Kodak qui a perdu son emploi à cause des mauvaises décisions technologiques de son employeur ? Aide-t-on un chasseur dont les problèmes sont principalement liés à sa paresse ? Les Danois et les Américains répondent à ces questions presque à l’identique. Ce qui est en jeu n’est pas l’aide en tant que telle, mais si elle sera donnée à quelqu’un qui la mérite ou non. Et c’est là que les deux populations diffèrent. Alors que la plupart des Danois pensent que le chômeur est probablement quelqu’un qui n’a pas eu de chance et qui trouvera un emploi avec de l’aide, la plupart des Américains pensent que le chômeur est paresseux et que l’aide ne ferait que l’encourager à être paresseux. Une appréciation aussi fondamentale dans nos sociétés ne vient pas d’une vision morale différente, mais d’une différence dans l’appréciation des autres.
Il existe plusieurs approches de cette question, et les sciences cognitives ne sont qu’une partie d’un ensemble d’outils, toutes les sciences humaines jouent leur rôle.

« Lecteur. Fanatique de la cuisine professionnelle. Écrivain. Gourou d’Internet. Amateur de bière d’une humilité exaspérante. Fan de café sans vergogne. »